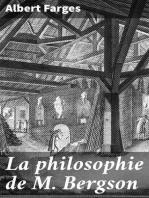Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
TD N°3. Histoire Et Réalité
Загружено:
31071978Оригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
TD N°3. Histoire Et Réalité
Загружено:
31071978Авторское право:
Доступные форматы
TD n°3 (EOD 2008-2009) 1
TD n°3 : L’historien et la réalité du passé
Vocabulaire : Vérité / Réalité / Scientificité (Objectivité / Subjectivité) / Plausibilité / Falsifiabilité
Document 1 : Roger Chartier, Au bord de la falaise, 1998.
Cette référence à une réalité située hors et avant le texte historique et que celui-ci a pour fonction de restituer à sa
manière, n’a été abdiquée par aucune des formes de la connaissance historique, mieux même, elle est ce qui
constitue l’histoire dans sa différence maintenue avec la fable et la fiction.
Document 2 : Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos, Introduction aux études historiques, 1898.
Par la nature même de ses matériaux, l’histoire est forcément une science subjective. Il serait légitime d’étendre à
cette analyse intellectuelle d’impressions subjectives les règles de l’analyse réelle d’objets réels. L’histoire doit donc
se défendre de la tentation d’imiter les sciences biologiques. Les faits historiques sont si différents de ceux des autres
sciences qu’il faut pour les étudier une méthode différente de toutes les autres.
Faits matériels, actes humains individuels et collectifs, faits psychiques, voilà tous les objets de la connaissance
historique : ils ne sont pas observés directement, ils sont tours imaginés. Les historiens – presque tous sans en avoir
conscience et en croyant observer des réalités – n’opèrent jamais que sur des images.
Comment donc imaginer des faits qui ne soient pas entièrement imaginaires ? Les faits imaginés par l’historien sont
forcément subjectifs : c’est une des raisons qu’on donne pour refuser à l’histoire le caractère de science. Mais
subjectif n’est pas synonyme d’irréel. Un souvenir n’est qu’une image et n’est pourtant pas une chimère, il est la
représentation d’une réalité passée.
Des faits que nous n’avons pas vus, décrits dans des termes qui ne nous permettent pas de nous les représenter
exactement, voilà les données de l’histoire. Toute image historique contient donc une forte part de fantaisie.
L’historien ne peut s’en délivrer mais il peut savoir le compte des éléments réels qui entrent dans ses images et ne
faire porter sa construction que sur ceux-là : ces éléments, ce sont ceux qu’il a tirés des documents. Le travail de
l’historien consiste à rectifier graduellement nos images en remplaçant un à un les traits faux par des traits exacts.
Document 3 : Christophe Charles, Bernard Delpal, Jean-Dominique Durand, Régis Ladous et Henry Morsel,
« L’historien et les falsificateurs », in Le Monde, 29 avril 1993.
Que peut faire la communauté universitaire face aux prises de position négationnistes d’un de ses membres ?
L’actualité récente a remis sur le devant de la scène « l’affaire » provoquée par un enseignant en sciences
économiques de Lyon-III qui tendait à nier les chambres à gaz.
Le recours à la justice constitue une solution insuffisante dès lors que les négationnistes ont l’habitude de focaliser le
débat sur la contestation de faits particuliers (de détails) et se gardent de toute affirmation raciste ou antisémite qui
tomberait sous le coup de la loi. Ainsi que Madeleine Rébérioux l’a écrit « la loi est de l’ordre du normatif. Elle ne
saurait dire le vrai (en Histoire) ». Dire le vrai en histoire… Nous sommes bien là au cœur du problème. La nature
de notre discipline la rend particulièrement fragile et l’expose plus que d’autres à des manipulations, au moins pour
quatre raisons. La compétence en matière historique semble d’abord la chose la mieux partagée du monde puisque
tout un chacun peut se proclamer historien. En deuxième lieu, la médiatisation des débats donne inévitablement
l’avantage à ceux qui nient en trois phrases expéditives face à ceux qui démontrent en quinze pages argumentées, à
ceux qui jouent la nouveauté provocatrice et l’ « effet d’annonce » face à ceux qui démontent patiemment les
falsifications. En troisième lieu l’écriture de l’histoire, parce qu’elle conditionne la mémoire collective, constitue un
enjeu prioritaire pour tout mouvement qui ambitionne la gestion des esprits. Enfin la vérité historique est toujours
relative à l’historien qui la construit et aux traces du passé qu’il retrouve, ce que d’aucuns transforment tout de suite
abusivement en adage du type « vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ».
À une démarche qui part de points particuliers pour jeter le soupçon, par cercles concentriques, sur les moyens,
puis l’ampleur, enfin la réalité du génocide, nous devons opposer une démarche qui réponde à la provocation par :
1. La responsabilité. Une déontologie s’impose à tout enseignant. Elle lui interdit de dire n’importe quoi et de
porter la suspicion sur des réalités humaines tragiques sous prétexte de jouer avec les mots ou les idées.
2. L’affirmation vigoureuse que l’histoire est une spécialité. Comme telle, elle exige une apprentissage et
l’acceptation de soumettre ses travaux à la critique de la communauté scientifique.
3. La fidélité à une méthode. L’hypercritique négationniste peut s’appliquer à tout objet historique et a permis de
nier jusqu’à l’existence de Napoléon. Or, il existe des faits irréductibles à une quelconque subjectivité historique.
Document 4 : Carlo Ginzburg, Le juge et l’historien, 1991.
Pour de nombreux historiens, la notion de preuve n’est plus à la mode, de même que celle de vérité, à laquelle elle
est nouée par un lien historique (donc non nécessaire) très fort. Les raisons de cette dévalorisation sont nombreuses
TD n°3 (EOD 2008-2009) 2
et ne sont pas toutes d’ordre intellectuel. L’une d’elles est, à n’en pas douter, le succès exagéré qu’a obtenu de part
et d’autre de l’Atlantique, aux États-Unis et en France, le terme de « représentation ». Étant donné l’usage qu’on en
fait, il finit dans bien des cas par créer autour de l’historien un mur infranchissable. On tend à examiner la source
historique exclusivement en tant que source d’elle-même (de la façon dont elle a été construite) et non de ce dont
elle parle. En d’autres termes, on analyse les sources (écrites, iconographiques, etc.) en tant que témoignages de
« représentations » sociales, mais, en même temps, on refuse, comme une impardonnable naïveté positiviste, la
possibilité d’analyse les rapports entre ces témoignages et les réalités qu’ils désignent ou représentent. Certes, ces
rapports ne sont jamais évidents : les définir en termes de reflets, voilà ce qui serait, pour le coup, naïf. Nous savons
bien que tout témoignage est construit selon un code déterminé : atteindre la réalité historique (ou la réalité) en
prise directe est, par définition, impossible. Mais inférer de cela l’impossibilité de connaître la réalité signifie tomber
dans une forme de scepticisme radical par paresse qui est à la fois insoutenable d’un point de vue existentiel et
contradictoire du point de vue logique : comme on le sait, le choix fondamental du sceptique n’est pas soumis au
doute méthodique qu’il prétend professer.
Pour moi, comme pour beaucoup d’autres, les notions de « preuve » et de « vérité » sont, au contraire, partie
intégrante du métier l’historien. Cela n’implique évidemment pas que des phénomènes inexistants ou des
documents falsifiés soient peu signifiants sur le plan historique : Bloch et Lefebvre nous ont enseigné le contraire
depuis bien longtemps. Mais l’analyse des représentations ne peut faire abstraction du principe de réalité.
Document 5 : Guy Lardeau, Préface aux Dialogues avec Georges Duby, 1980.
La question qui s’offre la première, comme celle qui proprement décide de l’ordre des raisons, c’est celle qui
demande ce qu’il en est du « passé » : l’histoire, comme discours, se soutient-elle d’un réel, réel évanoui, mais qui
insiste pour retourner à l’être – ou bien est-ce l’histoire, comme objet, dont il faut dire qu’elle n’est suscitée que du
discours qui la nomme, pur effet de nomination ?
Le problème n’est pas – n’est plus – entre une théorie naïvement empiriste et une théorie constructiviste : Langlois
et Seignobos, quels qu’aient été leurs mérites par ailleurs, retardaient déjà par rapport à Claude Bernard et Pasteur,
et il n’y a pas plus aujourd’hui en histoire que dans quelque domaine que ce soit du savoir de savant qui nierait que
son objet est construit. Le problème est de savoir si c’est sur du réel que se découpe cet objet construit, si c’est un
réel qui pèse sur cette construction, et la contraint, ou si l’objet n’est rien que cette construction même, pur effet de
discours, un ensemble cohérent de noms, dont le « réel» s’épuise en cette cohérence même ; car l’historien, alors, a
bien affaire à un « réel », en ce sens qu’il ne peut pas dire n’importe quoi, mais ce réel n’est rien d’autre que celui
que produit l’application au corpus qu’il s’est donné des règles qu’il a choisies.
Sur cet affrontement du réalisme et du nominalisme, […]je serai ici très bref. En quelques mots, disons que, poussé
à sa conséquence extrême, le point de vue nominaliste nous conduirait à dire quelque chose comme ceci : le
« passé », comme tel, n’est pas ; s’il existe ce n’est jamais que comme la nécessaire épaisseur que chaque présent se
donne, un des modes selon lequel le présent se présente en s’inventant la profondeur d’une origine, et par là se
garantit, s’autorise, proprement ; c’est la manière spécifique aux sociétés occidentales de régler cette invention du
passé, que nous appelons l’histoire : l’histoire alors est un style, les règles, qui durement la contraignent, celles d’un
genre. Ainsi, il n’y a que des discours sur le passé, qui n’est rien que ces discours où, chaque fois, se mobilisent les
intérêts du présent. Ballet rigoureusement mis en scène de masques qui s’offrent à figurer les intérêts, les conflits du
présent, où les rôles changent, mais non les places, l’histoire est la garde-robe des inscriptions imaginaires,
l’historien ce costumier qui ajuste des costumes qui n’ont jamais été neufs : l’histoire est faite de l’étoffe même des
rêves, notre petite mémoire est enveloppée d’un somme.
Document 6 : Gérard Lenclud, in Terrain, n°21, octobre 1993.
« Il en est des définitions comme des ceintures : plus elles sont courtes, plus elles doivent être élastiques », écrit
Stephen Toulmin. L’ambition d’établir un répertoire de définitions ramassées, dont chacune vaudrait pour la plus
vaste collection d’exemples possibles, est tenace au sein de la communauté scientifique mais, commente le
philosophe anglo-saxon, « il est fort instructif de voir quel degré précis d’élasticité on demande en fin de compte à
ces définitions raccourcies. […] « Dis-moi comment l’on te cherche, lançait aux objets de connaissance Gaston
BAchelard, je te dirai qui tu es ». Adaptons la formule la formule à la métaphore de Toulmin : dis-moi comment on
t’habille, je te dirai qui tu es. Les phénomènes étudiés par les sciences de la nature, plus exactement par certaines
d’entre elles, s’habillent en prêt-à-porter. C’est que ces phénomènes ne sont pas trouvés « tout faits » ; ils sont
élaborés par une expérience qui fait corps avec la définition. Il est donc parfaitement inimaginable que la définition
ne leur aille pas ; ils s’évaporeraient du même coup. Les phénomènes que les sciences humaines et sociales
cherchent à décrire doivent, quant à eux, être costumés sur mesure. C’est qu’ils sont situés dans le monde
historique ; à la différence de véritables êtres scientifiques, ils préexistent à l’essayage qui les transforme en objet de
connaissance.
Вам также может понравиться
- FEBVRE, Lucien. de La Théorie À La Pratique de L'histoire PDFДокумент9 страницFEBVRE, Lucien. de La Théorie À La Pratique de L'histoire PDFafurtadoОценок пока нет
- Introduction Aux Études HistoriquesДокумент3 страницыIntroduction Aux Études Historiquesallora16100% (2)
- Pierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesДокумент32 страницыPierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesPierrePachetОценок пока нет
- Description Et Interpretation Chez Clifford GeertzДокумент7 страницDescription Et Interpretation Chez Clifford GeertzdemaistreОценок пока нет
- La Relation Critique - StarobinskiДокумент26 страницLa Relation Critique - StarobinskiMatheus MullerОценок пока нет
- Thèse - Viennet - Temps, Développement, Pathologies PDFДокумент351 страницаThèse - Viennet - Temps, Développement, Pathologies PDFRodrigo CornejoОценок пока нет
- BEAUR Gerard. Les Catégories Sociales À La Campagne: Repenser Un Instrument D'analyseДокумент19 страницBEAUR Gerard. Les Catégories Sociales À La Campagne: Repenser Un Instrument D'analyse_enveОценок пока нет
- ARMAND MÜLLER - MontaigneДокумент50 страницARMAND MÜLLER - MontaigneMark CohenОценок пока нет
- CAILLET I.C. Albert L.: Manuel Bibliographique Vol. 1 A-D (3voll.)Документ616 страницCAILLET I.C. Albert L.: Manuel Bibliographique Vol. 1 A-D (3voll.)Acca Erma Settemonti100% (1)
- Hippolyte TaineДокумент6 страницHippolyte Tainedemetrios2017Оценок пока нет
- Pouilloux, Jean-Yves - Introduction Au Quart LivreДокумент14 страницPouilloux, Jean-Yves - Introduction Au Quart LivreNicolas MasvaleixОценок пока нет
- Cf36 La Pensee Ecologique Et Lespace Litteraire CompletДокумент185 страницCf36 La Pensee Ecologique Et Lespace Litteraire CompletStécieОценок пока нет
- Pourquoi Balibar ?, Par Vincent DescombesДокумент15 страницPourquoi Balibar ?, Par Vincent Descombesk1103634Оценок пока нет
- Anthropo Et Lumières PDFДокумент232 страницыAnthropo Et Lumières PDFduel9Оценок пока нет
- Faut-Il Vraiment Découper L'histoire en Tranches (Jacques Le Goff)Документ108 страницFaut-Il Vraiment Découper L'histoire en Tranches (Jacques Le Goff)Serhat OnurОценок пока нет
- Choonwoo YEE-LA NATURE DANS L'OEUVRE DE FRANCIS PONGEДокумент437 страницChoonwoo YEE-LA NATURE DANS L'OEUVRE DE FRANCIS PONGEunetreОценок пока нет
- CarloGinzburg Traces 1979-2Документ52 страницыCarloGinzburg Traces 1979-2RoRoОценок пока нет
- Syllabus 2017-18 Quadri 1 PHilosophieДокумент217 страницSyllabus 2017-18 Quadri 1 PHilosophieJeremias MuandaОценок пока нет
- Revue VAYNE Les Grecs Ont Ils Cru A Leurs MythesДокумент7 страницRevue VAYNE Les Grecs Ont Ils Cru A Leurs Mythesmegasthenis1Оценок пока нет
- Émergence de ProbabilitéДокумент5 страницÉmergence de Probabilitéachille7Оценок пока нет
- Durkheim (1893) de La Division Du Travail Social PDFДокумент502 страницыDurkheim (1893) de La Division Du Travail Social PDFVincent ColonnaОценок пока нет
- Flaubert Et Ses Lectures PDFДокумент134 страницыFlaubert Et Ses Lectures PDFJavier TusoОценок пока нет
- Michel Henry Et L'histoire de La Philosophie (Fichant) PDFДокумент16 страницMichel Henry Et L'histoire de La Philosophie (Fichant) PDFxfgcb qdljrkfgle100% (1)
- Economie Charles Gide, Charles Rist - Histoire Des Doctrines Economiques Depuis Les Physiocrates Jusqu'a Nos Jours (1922)Документ834 страницыEconomie Charles Gide, Charles Rist - Histoire Des Doctrines Economiques Depuis Les Physiocrates Jusqu'a Nos Jours (1922)taraselbulbaОценок пока нет
- Scheid - Comment Identifier Un Lieu de CulteДокумент10 страницScheid - Comment Identifier Un Lieu de CulteMaurizio GallinaОценок пока нет
- Communication 340 Vol 25 1 Jean Lohisse La Communication de La Transmission A La Relation Deuxieme Edition Revue Et Augmentee Par Annabelle KleinДокумент5 страницCommunication 340 Vol 25 1 Jean Lohisse La Communication de La Transmission A La Relation Deuxieme Edition Revue Et Augmentee Par Annabelle KleinCristina CurbătОценок пока нет
- La Vie LittéraireДокумент721 страницаLa Vie LittérairebleitesОценок пока нет
- Livret Agregation 2013Документ35 страницLivret Agregation 2013Lesabendio7Оценок пока нет
- F. Gros Introduction À La Philosophie de Michel Foucault. M.F. Une Philosophie de La VéritéДокумент7 страницF. Gros Introduction À La Philosophie de Michel Foucault. M.F. Une Philosophie de La VéritéNicolasCaballeroОценок пока нет
- CAN BATUKAN - Question de L'animal Chez Heidegger Et DeleuzeДокумент457 страницCAN BATUKAN - Question de L'animal Chez Heidegger Et DeleuzeCan BatukanОценок пока нет
- (Collection Des Universites de France (Budé) ) Aristote - Jacques Brunschwig (Ed.) - Topiques 1+2 (1967, 2007, Les Belles Lettres) - Libgen - LiДокумент968 страниц(Collection Des Universites de France (Budé) ) Aristote - Jacques Brunschwig (Ed.) - Topiques 1+2 (1967, 2007, Les Belles Lettres) - Libgen - LiSperanzaОценок пока нет
- 2014 Bourdin Bernard TheseДокумент390 страниц2014 Bourdin Bernard TheseYamila JuriОценок пока нет
- CH - Seignobos - Histoire de La Civilisation ContemporaineДокумент452 страницыCH - Seignobos - Histoire de La Civilisation Contemporainebelgam2Оценок пока нет
- Image Sémiologique PDFДокумент20 страницImage Sémiologique PDFDesertRoseОценок пока нет
- Luchelli, J.P. - These Le TransfertДокумент310 страницLuchelli, J.P. - These Le TransfertPatricio Andrés BelloОценок пока нет
- L'anarchieДокумент12 страницL'anarchieDuncan GnahouaОценок пока нет
- L2 Descriptifs 2018 2019Документ50 страницL2 Descriptifs 2018 2019Link ZeldaОценок пока нет
- W. Benjamin - Le Concept D'histoireДокумент8 страницW. Benjamin - Le Concept D'histoireghitzzОценок пока нет
- La Géocritique Selon Westphal (Note de Lecture)Документ6 страницLa Géocritique Selon Westphal (Note de Lecture)houcine720% (1)
- Philosophes Contemporains - Gabriel Marcel, Maurice - Tilliette, Xavier - 1962 - Paris, Desclée de Brouwer - Anna's ArchiveДокумент120 страницPhilosophes Contemporains - Gabriel Marcel, Maurice - Tilliette, Xavier - 1962 - Paris, Desclée de Brouwer - Anna's ArchiveRebèl Jan Batis ViksamaОценок пока нет
- Autofiction Vs AutobiographieДокумент15 страницAutofiction Vs AutobiographieSarah SlimaniОценок пока нет
- Cours Epistemologie Histoire 2 PDFДокумент109 страницCours Epistemologie Histoire 2 PDFabou abdouОценок пока нет
- Fiche de LectureДокумент3 страницыFiche de LectureCamille Mimi67% (6)
- Althusser La Solitude de MachiavelДокумент15 страницAlthusser La Solitude de MachiavelDavid FielОценок пока нет
- Exposé Littérature ComparéeДокумент5 страницExposé Littérature ComparéeManon AlvesОценок пока нет
- Revolution Annee 1789 EvaluationДокумент1 страницаRevolution Annee 1789 EvaluationJean-Philippe Solanet-Moulin100% (2)
- Debray Fiche de Lecture MédiologieДокумент4 страницыDebray Fiche de Lecture MédiologieObjectif ComprendreОценок пока нет
- Jacques Le Goff, Faut-Il Vraiment Decouper L'histoire en TranchesДокумент22 страницыJacques Le Goff, Faut-Il Vraiment Decouper L'histoire en TranchesakansrlОценок пока нет
- Lire Et Apprendre A Lire A L'ecole Primaire La Question Du Texte LitteraireДокумент198 страницLire Et Apprendre A Lire A L'ecole Primaire La Question Du Texte Litterairesara sara100% (1)
- Humour. Panorama de La Notion Fabula - OrgДокумент84 страницыHumour. Panorama de La Notion Fabula - OrgΑντριάννα Καραβασίλη100% (1)
- Rapport Préliminaire de La Commission Pour La Vérité Sur La Dette Publique GrecqueДокумент64 страницыRapport Préliminaire de La Commission Pour La Vérité Sur La Dette Publique GrecqueCADTM100% (2)
- Michel Foucault. La Peinture de Manet. Conférence À Tunis, Le 20 Mai 1971. Résumé Avec Illustrations.Документ17 страницMichel Foucault. La Peinture de Manet. Conférence À Tunis, Le 20 Mai 1971. Résumé Avec Illustrations.Veronikaoltre100% (1)
- Derrida - Resistances de La Psychanalyse Jacques DerridaДокумент18 страницDerrida - Resistances de La Psychanalyse Jacques DerridaDaniel AttalaОценок пока нет
- Spinoza Et La Méthode Générale de M. Gueroult - DeleuzeДокумент13 страницSpinoza Et La Méthode Générale de M. Gueroult - DeleuzedekknОценок пока нет
- De La Sociocritique À L'argumentationДокумент17 страницDe La Sociocritique À L'argumentationMauro AsnesОценок пока нет
- Nouveaux Essais Sur L'entendement Humain (... ) Leibniz Gottfried Bpt6k5667240gДокумент278 страницNouveaux Essais Sur L'entendement Humain (... ) Leibniz Gottfried Bpt6k5667240ggrão-de-bicoОценок пока нет
- La science romanesque de Jules Verne: Étude d'un genre littéraireОт EverandLa science romanesque de Jules Verne: Étude d'un genre littéraireОценок пока нет
- CO - Genre, Sexe Et PolitiqueДокумент15 страницCO - Genre, Sexe Et Politique31071978Оценок пока нет
- Bulletin Adhésion ARGEFДокумент1 страницаBulletin Adhésion ARGEF31071978Оценок пока нет
- 8 MarsДокумент10 страниц8 Mars31071978Оценок пока нет
- Co 1 PDFДокумент26 страницCo 1 PDF31071978Оценок пока нет
- Vendre Son CorpsДокумент14 страницVendre Son Corps31071978Оценок пока нет
- Sexisme Et Estime de SoiДокумент21 страницаSexisme Et Estime de Soi31071978Оценок пока нет
- ProgrammeДокумент1 страницаProgramme31071978Оценок пока нет
- Doc. S2 PDFДокумент3 страницыDoc. S2 PDF31071978100% (1)
- Documents S1 PDFДокумент4 страницыDocuments S1 PDF31071978Оценок пока нет
- S3Документ24 страницыS331071978Оценок пока нет
- Séance 5Документ26 страницSéance 531071978Оценок пока нет
- Séance 9Документ38 страницSéance 931071978Оценок пока нет
- Féminisme MondialisationДокумент24 страницыFéminisme Mondialisation31071978Оценок пока нет
- Séance 4Документ33 страницыSéance 431071978Оценок пока нет
- Co Iep S3Документ22 страницыCo Iep S331071978Оценок пока нет
- Séance 6Документ26 страницSéance 631071978Оценок пока нет
- CO - Genre, Sexe Et PolitiqueДокумент15 страницCO - Genre, Sexe Et Politique31071978Оценок пока нет
- Séance 4Документ33 страницыSéance 431071978Оценок пока нет
- Séance 5Документ26 страницSéance 531071978Оценок пока нет
- Séance N°7Документ20 страницSéance N°731071978Оценок пока нет
- Séance 8Документ23 страницыSéance 831071978Оценок пока нет
- Violence Contre Les FemmesДокумент1 страницаViolence Contre Les Femmes31071978Оценок пока нет
- IRM HypothèsesДокумент6 страницIRM HypothèsesMuriel SALLEОценок пока нет
- Comment Peut-On Être FéministeДокумент31 страницаComment Peut-On Être Féministe31071978Оценок пока нет
- Féminisme IslamiqueДокумент19 страницFéminisme Islamique31071978Оценок пока нет
- Doc. S2Документ2 страницыDoc. S231071978Оценок пока нет
- Intersection Article DorlinДокумент12 страницIntersection Article Dorlin31071978Оценок пока нет
- Présentation 24 - 01 - 2021Документ14 страницPrésentation 24 - 01 - 202131071978Оценок пока нет
- 1 - Définition Des Concepts-Clés Relatifs Au GenreДокумент4 страницы1 - Définition Des Concepts-Clés Relatifs Au Genre31071978100% (2)
- Compréhension Écrite C1 - La Génération D....Документ4 страницыCompréhension Écrite C1 - La Génération D....Carmen PănuțăОценок пока нет
- Exposé de FrançaisДокумент4 страницыExposé de Françaisworld.center.tech225Оценок пока нет
- Rapport Itie Tchad 2016Документ182 страницыRapport Itie Tchad 2016Hassan MhtОценок пока нет
- CATALOGUE A4 Numismatique MDC 04-10-2017 NumeriqueДокумент484 страницыCATALOGUE A4 Numismatique MDC 04-10-2017 NumeriqueAlessandro AzzolaОценок пока нет
- DELF B2 Production Orale Sujet 3Документ1 страницаDELF B2 Production Orale Sujet 3Tanvi NaikОценок пока нет
- Le PouvourДокумент12 страницLe PouvourHamza El MakhloufiОценок пока нет
- Verbes Et Leurs PrépositionsДокумент5 страницVerbes Et Leurs PrépositionsFlaquitaEndeje100% (1)
- La Bonne Gouvernance Au Maroc - Partie 1 PDFДокумент0 страницLa Bonne Gouvernance Au Maroc - Partie 1 PDFAmine MJ BouyzemОценок пока нет
- HOUDRET These FR Conflits Eau MarocДокумент74 страницыHOUDRET These FR Conflits Eau MarocMohamed RaouОценок пока нет
- Omd Rapport Unesco 2015 EngДокумент28 страницOmd Rapport Unesco 2015 EngGiser TakoustОценок пока нет
- Genette, Gérard Mimologiques. Voyages en Cratylie, Paris, Éditions Du Seuil, 1976 (Collection Poétique, 427 P.)Документ5 страницGenette, Gérard Mimologiques. Voyages en Cratylie, Paris, Éditions Du Seuil, 1976 (Collection Poétique, 427 P.)Kichou MouradОценок пока нет
- Compreehension Orale-B2-AДокумент2 страницыCompreehension Orale-B2-ARANJANA MUNJALОценок пока нет
- Le Kaïzen Exemplaire WordДокумент3 страницыLe Kaïzen Exemplaire WordOukassou MohamedОценок пока нет
- 2nde - H0-La PériodisationДокумент3 страницы2nde - H0-La PériodisationSamuel Duval (RAESRSE7EN)Оценок пока нет
- Cv-Wihtol de Wenden-Catherine PDFДокумент5 страницCv-Wihtol de Wenden-Catherine PDFstumpfrenchОценок пока нет
- Dislog GroupДокумент10 страницDislog GroupSara ElouazaniОценок пока нет
- KPM Tarifs Maritimes Chine-CongoДокумент1 страницаKPM Tarifs Maritimes Chine-CongoRachisОценок пока нет
- Entraînez VousДокумент4 страницыEntraînez VousAlina AlinaОценок пока нет
- JMP 2017 Wash in The 2030 Agenda FRДокумент8 страницJMP 2017 Wash in The 2030 Agenda FRbassemonlineОценок пока нет
- RESUME DU COURS DE TERMINALE DFДокумент42 страницыRESUME DU COURS DE TERMINALE DFwk4pnnk7dw0% (1)
- GeopolitiqueДокумент3 страницыGeopolitiqueSoukaina TadlaouiОценок пока нет
- 25 Most Important MistakesДокумент32 страницы25 Most Important Mistakeshmid100% (1)